Les Peuples de la Mer en Corse et Sardaigne?
Les Égyptiens de l'Antiquité appelaient Peuples de la mer (ou Peuples du Nord) des groupes de différents peuples venus attaquer sans succès à au moins deux reprises la région du delta, sous les règnes de Mérenptah et de Ramsès III, à la fin du XIIIe siècle av. J.-C. et au début du XIIe siècle av. J.-C., à la fin de l'Âge du bronze récent (période du Nouvel Empire égyptien).
On comptait parmi eux les Lukkas (Lyciens), Peleset (Philistins), Shardanes et Shekelesh, entre autres. Certains de ces mêmes peuples sont présents dans les textes provenant de régions plus au nord, sur les côtes d'Anatolie méridionale et du Levant, où ils mettent à mal les royaumes dominés par les Hittites et prennent part à leur chute. Certains d'entre eux s'installent ensuite au Proche-Orient, les plus importants étant les Philistins.
il est une thèse affirmant que la Sardaigne et la Sicile ont été (en partie) peuplées par deux peuples faisant partie de la confédération des Peuples de la Mer, chacun des deux peuples ayant donné leur nom à la nouvelle terre qu'ils ont abordée: Sardaigne pour les Shardanes, et Sicile pour les Shekelesh.
Mention de ces peuples dans les sources égyptiennes:
" šrdn " pour les Shardanes
" šqrš " pour Shekelesh
Ce n'est qu'au prix du phénomène linguistique nommé apocope que le terme šqrš donne "SiCiLe", avec disparition du "sh" final, le "r" et le "l" étant en fait le même phonème, puisque le "l" était inconnu des égyptiens.
Or, mon hypothèse est que ce même peuple Shekeresh ne s'est pas intégralement fixé en Sicile, et a accompagné les Shardanes plus à l'ouest et au Nord. Et que ces même šqrš ont donné leur nom à la Corse, plus précisément au peuple torréen, Korsi, voisin de leurs cousins shardanes nurraghiques.
Ainsi, "Kors" et "Sicil" auraient la même origine, mais dans le cas de la Corse, il y a linguistiquement une aphérèse (chute de la première syllabe):
aphérèse: sh-q-r-š >> k-r-s
apocope: š-q-r-sh >> s-c-r
Ce même peuplement shekelsh pourrait expliquer la grande proximité linguistique entre le corse et le sicilien (plus forte qu'entre le corse et le sarde, ou encore qu'entre le sarde et le sicilien), alors que d'un point de vue du brassage génétique récent (antiquité tardive), le peuple corse est génétiquement plus proche du peuple sarde que du peuple sicilien, qui a connu de nombreuses invasions que n'ont pas forcément connu les îles plus septentrionales (en tout cas pas dans les mêmes proportions). En d'autres termes, la Sardaigne et la Corse seraient restées "génétiquement" davantage shardano-shekelesh que la très populeuse Sicile (5M d'hab), véritable porte-avion de la méditerranée.
Cette origine commune aux 3 îles pourrait peut-être expliquer la présence du son cacuminal ("dd" pour "ll") dans les langues respectives de ces îles.
les trois îles ont sans doute un ancien peuplement commun (shardano-shekelsh) dont pourrait faire trace le substrat propre à ces langues (son cacuminal, certains éléments du lexique -"ghjacaru" pour "chien" etc.).
La Sicile a cependant un peuplement plus diversifié du fait de son histoire (ce qui expliquerait sa démographie actuelle) alors que Corse et Sardaigne, malgré les invasions qu'elles ont connues (souvent cantonnées au littoral), ont subi un isolement plus prononcé, et dont les gènes seraient plus proches de leurs lointains ancêtres anatoliens.
C'est l'hypothèse que j'émets d'après les thèses déjà formulées, sur la base d'une intuition linguistique, étant linguiste de formation. Je serais ravi de voir des historiens étayer à ma suite mon hypothèse.
L'archéologue israélien Adam Zertal avance une hypothèse selon laquelle le site d'el-Ahwat présente des similitudes avec des sites sardes nurraghiques, et serait le fait de populations appartenant à ces peuples de la mer.
Lingua Corsa - langue Corse
La langue corse est une langue romane, qui appartient au groupe italo-roman, elle est très proche des dialectes d'Italie centrale et méridionale (par exemple du sicilien). La langue corse est subdivisée en deux groupes dialectaux principaux, le cismuntincu (appellation traditionnelle : cismontano), très proche du toscan (la langue romane qui a donné naissance à l'italien moderne), et le pumuntincu (appellation traditionnelle : oltramontano), qui présente des caractéristiques communes avec les parlers de l'Italie méridionale, mais aussi avec le sarde et surtout la langue sicilienne. Cet ensemble de dialectes corses présente une unité réelle, en ce sens que des règles au niveau de l'écriture permettent, par exemple, de passer de l'un à l'autre (langue-toit). Cette coexistence de l'unité et de la variété a donné naissance au concept sociolinguistique de langue polynomique.
La langue corse est parlée en Corse mais également au nord de la Sardaigne (en ce qui concerne sa variante pumuntincu, avec les dialectes du gallurais). Son statut de langue proprement dite est relativement récent (il date des années 1960), et est contesté par de nombreux linguistes, qui y voient une revendication politique sans fondement du point de vue linguistique. Au sens de la classification établie par l'Unesco, le corse fait partie des langues menacées de disparition avant la fin du siècle.
Au sein des langues romanes, le corse appartient au groupe linguistique italo-roman. La langue corse est employée dans l'ensemble de l'île (sans que son emploi y soit généralisé), à l'exception des villes de Bonifacio et de Calvi, où l'on parle encore un dialecte ligure d'origine génoise. Du fait d'une ancienne et forte émigration de Corses sur l'île de la Maddalena, au nord de la Sardaigne, on y parle le même corse qu'à Sartène. Le gallurais ou gallurien (gallurese ou gadduresu), dialecte de la région de la Gallura, au nord de la Sardaigne, est également très proche des parlers du sud de la Corse (ceux-ci sont d'ailleurs plus proches entre eux qu'avec les autres variantes du corse, cf. R.A. Hall, Jr.), alors que le sarde proprement dit doit être considéré comme une langue nettement distincte (elle est très différente de l'italien et de ses différents dialectes). Par exemple, tous ces dialectes corses et non-sardes de Sardaigne ont un pluriel en -i comme en italien, alors que le pluriel sarde typique est en -s (comme en français ou en espagnol). A la différence de ces dialectes, la variante dialectique du Pumonte donne un masculin pluriel en A et non en I. Par exemple, les mots homme ou sou : un omu,un soldu ; dui omi, dui soldi (Cismonte); un omu, un soldu ; dui oma, dui solda (Pumonte). Cette terminaison est plus proche du pluriel latin.[réf. nécessaire] Néanmoins, un substrat probablement commun aux deux langues sarde et corse et l'appartenance à une Romania africana donnent de nombreux traits communs aux deux langues, renforcés par l'ancienne et importante occupation pisane et aragonaise commune. Le son cacuminal, partagé par le dialecte de Sartène et la plupart des dialectes sardes, ou l'interjection (très fréquente) [a'jo]!, commune dans les deux îles, en sont des traces encore plus anciennes (antérieures, sans doute, à l'occupation phénicienne des deux îles). Le sassarese (ou sassarais) est également très proche du corse, toujours à cause du substrat mixte sardo-corse[réf. nécessaire]. Il est parlé à Sassari et à proximité, à partir du XIIe siècle en tant que dialecte marchand entre les différents peuples de la ville nouveau-née (notamment sardes, corses, génois et pisans, après catalans et espagnols), avec une évolution liée au sarde logudorais, autonome du corse et gallurais.
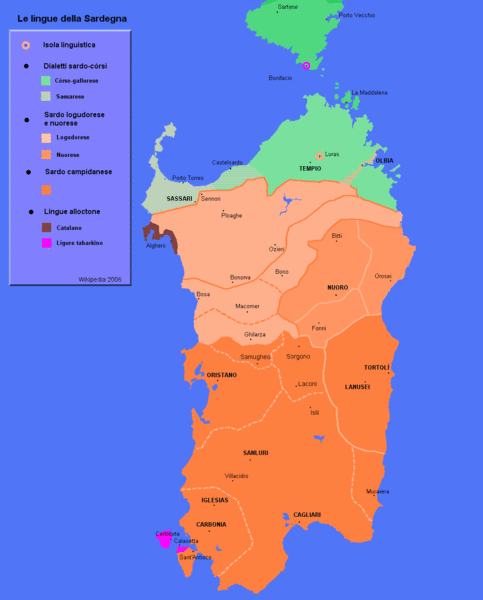
Les principales variantes du corse sont le sartenais, qui englobe le gallurais de Sardaigne, le taravais, le corse de la région de Vico-Ajaccio, le corse septentrional (Cap Corse et Bastia), le balanin et le dialecte de Venaco. Traditionnellement, tous ces dialectes sont répartis en deux groupes : le cismontincu et le pumontincu. La ressemblance du lexique varie entre 79 et 89 %. Le dialecte génois de Bonifacio est le plus proche de celui de Bastia avec 78 % de ressemblance lexicale.
Au Pumonti, on utilise le son cacuminal (quiddu contre quellu — celui, celui-là, ce — du cismonte). Autre similitude avec le mezzogiorno, le son /è/ en final d'un mot n'existe pas au Pumonte : u pastori ou a nazioni contre « u pastore » ou a nazione au Cismonte. Enfin, là où le centre et le nord de l'île emploie le /o/ ou le /è/, le sartenais maintient le /u/ ou le /i/ : u curri contre u corre au cismonte. Le pumontincu comporte de nombreux traits méridionaux mais reste substantiellement un dialecte toscan.
Notons que le Corse le plus traditionnel se rapproche du parler pumontincu. En effet, celui-ci est plus archaïque linguistiquement, dans le sens où il a subi moins d'évolutions par rapport aux langues mélangées du passé. Le cismonticu, lui, se rapproche du parler italien, avec la prédominance du "o", et des éloignements volontaires non naturels du parler. Par exemple, les lettres associées "st" dans un mot se prononceront "cht" : Bastia / Bachtia. Ce "cht" n'avait aucune raison d'exister, jusqu'à son apparition où il ne permettait que l'éloignement du Français, l'éloignant alors d'une langue corse pure.
Italiano
I passatempi
Sono nato a Roma e vi ho passato gli anni migliori della mia giovinezza. Ricordo, quando eravamo ragazzi, che le nostre mamme ci mandavano da soli a fare il bagno. Allora la spiaggia era piena di sabbia, senza scogli né rocce e si stava in mare delle ore fino a quando, paonazzi dal freddo poi ci andavamo a rotolare in quella sabbia bollente dal sole. Poi l'ultimo tuffo per levarci la sabbia attaccata alla pelle e ritornavamo a casa che il sole era già calato, all'ora di cena. Quando faceva buio noi ragazzi ci mandavano a fare granchi, con la luce, che serviva per mettere l'esca agli ami per pescare. Ne raccoglievamo in quantità poi in casa li mettevamo in un sacchetto chiuso in cucina. Una mattina in cui ci eravamo alzati che era ancora buio, quando siamo andati a prendere il sacchetto era vuoto e i granchi giravano per tutte le camere e c'è voluta più di mezz'ora per raccoglierli tutti.
Còrso cismontano
I passatempi
Sò natu in Corsica è v'aghju passatu i megli anni di a mio ghjuventù. Ricordu quand'èramu zitelli chì e nostre mamme ci mandavanu soli a fà u bagnu. Tandu a piaghja era piena di rena, senza scogli né cotule e ci ne stàvamu in mare per ore fin'à quandu, viola per u freddu, dopu ci n'andavamu a vultulàcci in quella rena bullente da u sole. Po' l'ultima capiciuttata per levacci a rena attaccata à a pelle è vultavamu in casa chì u sole era di ghjà calatu, à l'ora di a cena. Quandu facìa bughju à noi zitèlli ci mandàvanu à fà granchi, cù u lume, chì ci vulìa per innescà l'ami per a pesca. N'arricuglìamu à mandilate piene po' in casa i punìamu ind'à un sacchéttu chjosu in cucina. Una mane chì c'èramu arritti ch'èra sempre bughju, quandu simu andati à piglià u sacchettu ellu èra biotu è i granchi giravanu per tutte e camere è c'hè vulsuta più di mezz'ora à ricoglilli tutti.
Còrso oltramontano
I passatempi
Sòcu natu in Corsica e v'agghju passatu i mèddu anni di a me ghjuvintù. M'ammentu quand'érami zitéddi chi i nosci mammi ci mandàiani da par no' a fàcci u bagnu. Tandu a piaghja ghjéra piena di rèna, senza scóddi né ròcchi e si staghjìa in mari ori fin'a quandu, viola da u fritu andàghjìami a vultulàcci in quidda rèna buddènti da u soli. Dapo', l'ultima capuzzina pa' livàcci a réna attaccata a à péddi e turràiami in casa chi u soli era ghjà calatu, à l'ora di cena. Quandu facìa bugghju à no' zitéddi ci mandàiani à fa' granci, cù a luci, chi ci vulìa par inniscà l'ami pa' piscà. N'arricuglivàmi a mandili pieni e dapoi in casa i mittìami drent'a un sacchettu chjusu in cucina. Una matìna chi ci n'érami pisàti chi ghjéra sempri bughju, quandu sèmu andati à piddà u sacchéttu iddu éra biotu è i granci ghjiràiani pa' tutti i càmmari e c'hè vuluta più di mez'ora pa' ricapizzulàlli tutti.
Gallurese Provincia di Olbia-Tempio
Li passatempi
Sòcu natu in Gaddura e v'agghju passatu li mèddu anni di la mè ciuintù. M'ammentu candu érami stéddi chi li nostri mammi ci mandàani da pal noi a fàcci u bagnu. Tandu la piaghja éra piena di rèna, senza scóddi e né ròcchi e si stagghjìa in mari ori fin'a candu, biaìtti da lu fritu andaghjìami a vultulàcci in chidda rèna buddènti da lu soli. Dapoi, l'ultima capuzzina pa' bucàcci la réna attaccata a la péddi e turràami in casa chi lu soli éra ghjà calatu, a l'ora di cena. Candu facìa bugghju a noi stéddi ci mandàani a fa' granchi, cù la luci, chi vi vulìa pa' accindì(attivà) l'ami pa' piscà. N'accapitàami a mandili pieni e dapoi in casa li mittìami indrent'a un sacchéddu chjusu in cucina. Una matìna chi ci n'érami pisàti chi éra sempri lu bugghju, candu sèmu andati a piddà lu sacchéddu iddu éra bòitu e li granchi ghjràani pa' tutti li càmbari e v'è vuluta più di mez'ora pa' accapitàlli tutti.
Sassarese Sassari
Li passatempi
Soggu naddu a Sassari è v'aggiu passaddu li megli’anni di la mé pizzinìa. M’ammentu, cand’erami minori, chi li nosthri mammi zi mandàbani a fazzi lu bagnu à la sora. Tandu l'ippiaggia era piena di rena, senza ischògliu è rocca è si isthazzìa à mogliu ori finz’a candu, biatti da lu freddu andàbami a busthurazzi in chidda rena buddendi da lu sori. A dabboi l’usthimu cabuzzoni pà bugganni la rena appizzigadda à la peddhi è turrabami à casa chi lu sori era già caraddu, à l’ora di zinà. Candu si fazzia buggiu à noi pizzinni zi mandàbani a piglià granchi, cù la luzi chi vi vurìa pà innischà l'amu pà pischà. Ni pigliàbami umbè e dabboi in casa li punìami drentu a un sacchettu sarraddu i’ la cuzina. Un manzanu chi zi n’erami pisaddi chi era ancora buggiu, candu semmu andaddi a piglià lu sacchettu eddu era bioddu è li granchi giràbani pà tutti li càmmari è v'è vurudda più di mezz'ora pà accuglìnniri tutti.
Castellanese Castelsardo
Li passatempi
Soggu naddu a Castheddu è v'aghju passaddu li megli' anni di la piccinìa mea . M'ammentu cand'èrami minori chi li mammi nosthri ci mandavani a la sola/da pal noi a fàcci lu bagnu . Tandu la shlppiaggja era piena di rena, senza schogli né rocchi e s'isthaggia ori finz'a candu, biàtti da lu freddu andagiami a busthulacci in chissa rena buddendi da lu soli. Dabboi l'ulthimu cabucioni pà buggacci la rena attaccadda a la pèddi e turravami in casa chi lu soli era gjà caladdu, a l'ora di cinà. Candu fagia bughju à noi piccinni ci mandavani a piglià ganci, cù la lugi chi vi vulia pà innischà l'àmu pà pischà. Ni pigliavami umbè é dabboi in casa li puniami a drentu un saccheddu sarraddu i' la cucina. Un mangianu chi ci n'erami pisaddi chi era ancora bughju (chitzu), candu semmu andaddi à piglià lu sacchettu eddu era boiddu é li ganci giràvani pàl tutti li càmmari è v'é vuludda più di mezz'ora pà accuglinnili tutti.
u Mazzerismu - le Mazzerisme
Le mazzérisme est une croyance corse en un don de prophétie funèbre accompli en rêve par des individus liés à la communauté. Au cours de cette activité, le corps spectral du mazzeru part chasser et tuer des animaux. On le surnomme « Le Chasseur d'âmes » ou encore « Le Messager de la Mort ».
Origine
Le mazzérisme se localise essentiellement en Corse. Selon certains, il remonte probablement à une période plus ancienne que la religion mégalithique, celle du peuple de la chasse et de la cueillette, selon d'autres, l'origine de ces croyances est à rechercher au sein même de l'Eglise. Le lien mystique entre le mazzeru et sa victime fait écho à celui qui devait exister entre le chasseur pré-néolithique et sa proie. Il offre ainsi de nombreux points communs avec le chamanisme ( ce point est très discuté pour ne pas dire discrédité). Il est significatif que les autorités religieuses interdisaient aux prêtres d'aller à la chasse. Là où le mazzérisme a survécu le plus longtemps est précisément là où les chasseurs sont les plus nombreux !
Etymologie
« Mazzere » dérive de « mazza », ou d'« amazzà », qui signifie tuer. Suivant les régions, on le nomme « culpadore » (« colpatori » dans la région de Figari), « acciacatore », « mazzeru » (« mazzatori » à Gualdaricciu), « lanceri » dans le Sartenais, « nuttambuli » ou « sunnambuli » à Appiettu, « murtulaghj » à Marignana (Piana) et Corti. Le terme de masseriu signifignant massier est un terme connu du vocabulaire religieux sicilien. Il désigne la personne chargée d'introduire les fidèles dans l'église avant toute cérémonie. Le terme "mazzerisme"'est un nèologisme rècent (v 1975).
Les Mazzeri
Les Mazzeri chassent seuls. Bien qu'il soit une personne physique au même titre que tout le monde, ayant une vie sociale et personnelle, il est considéré par la communauté comme un être surnaturel liant l'au-delà au monde des vivants. Dans la vie courante, les mazzeri sont des êtres pacifiques. On reconnait les mazzeri à leur regard : ils ne vous regardent pas, mais regardent à travers vous. On dit que le mazzeru choisi devient absent, rêveur, qu'il aime la solitude et a des visions prophétiques. Il garde cet état dépressif et cette tristesse, sans doute parce qu'il a conscience d'être l'instrument involontaire de la mort comme l'est l'Ankou breton. L'ethnologie révèle que l'image du mazzeru se construit en opposition à la stregha ( la sorcière): Là où la stregha, antithèse de la femme au foyer fait le mal volontairement, le mazzeru donne la mort malgré lui et règle ainsi l'équilibre du cosmos. Dans le rapport à la communauté,malgré son pouvoir, le mazzeru est totalement intégré tandis que la stregha, image du chaos, vit à l'écart du monde civilisé.
La chasse et la prédiction
Leur arme préférée est un lourd bâton, un gourdin (« mazza »), mais ils utilisent aussi le fusil, la lance, la hache, le poignard, le couteau et les pierres.
Parce qu'il est au seuil de deux mondes, des religions, il appartient aux espaces frontaliers et aux lieux les plus sauvages, aux cols les plus désolés, aux gués, aux rivières. Ces croisements sont ses lieux de prédilections. La chasse se déroule en embuscade et suit le même schéma que la chasse traditionnelle, près des points d'eau, en des lieux incultes, sauvages et impénétrables. Les cours d'eaux marquent la limite d'un monde à l'autre. L'eau est aussi un lieu de prédilection des esprits, des morts qui n'ont pas expiés leurs péchés ; ces esprits sont en relation avec les mazzeri. Parfois ils chassent aussi dans les rues.
Une fois la bête tuée, il la retourne sur le dos et c'est alors qu'il voit se métamorphoser la tête d'un animal en visage d'une personne qu'il connaît et qui appartient à son espace social. La personne reconnue mourra infailliblement dans les trois jours à un an qui suit. Il peut ne faire que blesser un animal et la personne aura un accident ou tombera malade. Ce sont les mêmes parties du corps qui sont affectées. Sa fonction peut ainsi se révéler bénéfique : il peut agir sur le déroulement des choses et en changer le cours en faveur de l'individu qu'il reconnaîtra.
La chasse onirique
La période de chasse se déroule pendant les rêves. Le plus souvent, cela se passe près de chez elle, dans des paysages reconnaissables. La distinction entre rêves et réalité n'est pas aisée. Certains mazzeri sortent vraiment la nuit. D'autres ne sortent que pendant les rêves. Il y a alors une sorte de dédoublement de la personnalité. Difficile de savoir si ce sont les mazzeri qui rêvent ou les témoins qui prétendent les avoir vu dans leur activité, alors que les mazzeri ne se rappellent pas avoir rêvé ou être sorti la nuit.
L'explication des mazzeri : c'est leur âme ou esprit qui sort. L'esprit pendant la chasse, rencontre celui de sa victime qui a pris forme animale. Quand il tue l'animal, il sépare l'esprit du corps, le corps pouvant survivre quelque temps, mais cette survie n'est qu'un sursis.
Certains mazzeri racontent qu'ils vivent leurs rêves comme s'ils leur étaient imposés par une force supérieure, leurs actes échappant au contrôle de leur volonté. Ils ne peuvent même pas choisir leurs victimes. Toutes les personnes appelées à chasser en rêve ne réagissent pas de la même façon. Certains le font à contrecœur, sous la contrainte et la culpabilité, d'autres s'en réjouissent. Pour certains, la chasse devient une véritable drogue, une dépendance, exerçant une fascination sinistre.
La Mandrache
Les mazzeri d'un même village ne sont pas hostiles entre eux, à la différence d'avec ceux des autres villages. La Mandrache est une bataille entre les mazzeri de deux villages. Ils ont lieu habituellement sur un col. Cela se passe la nuit du 31 juillet au 1er août, groupé en milices, affrontant ceux de la communauté voisine. Cette guerre se fait à l'aide d'asphodèles. L'enjeu de cette guerre végétale détermine le taux de mortalité de l'année à venir, dans chacune des communautés. Chez les vainqueurs, la mortalité sera faible; chez les vaincus, forte.
Transmission du don et Guérison
Pour devenir mazzeru, il faut avoir un don psychique, dont l'origine est mystérieuse, et être initié, le plus souvent par un membre de la famille puisqu'il se transmet généralement de façon héréditaire. La vocation est obligatoire, on ne peut s'y soustraire. Tout au plus, l'initiateur peut faire en sorte que son nouveau confrère ne soit pas « mezzeru acciaccatore », c'est-à-dire tueur. Dans ce cas, il sera « mazzeru » tout court, c'est-à-dire « salvatore », sauveurs d'âmes et comparable en cela au chaman blanc ou au sorcier blanc de France, qui sont des guérisseurs.
Le mazzeru, pour Roccu Multedo, paraît être à la fois sacrificateur, psychopompe et guérisseur. L'animal chassé représente l'âme d'un malade qui s'ignore, que le mazzeru ne connaît pas encore, âme qui vient de quitter son corps. Ce départ de l'âme est justement la cause de la maladie. Le mazzeru sacrificateur poursuit l'animal et le tue afin de l'offrir à Dieu, et d'obtenir ainsi la guérison du malade. Il va s'agir ensuite pour le mazzeru guérisseur d'essayer d'arrêter l'hémorragie, de faire en sorte que le sang coagule et de faciliter au malade, ainsi privé de son âme, la périlleuse traversée du pont ou du gué qui constitue la frontière par excellence entre les deux mondes et ce, malgré les « mazzeri-acciaccatori » (tueurs) qui vont tout faire pour l'en empêcher.
Ulissi ind'è li Lestrigoni - Ulysse chez les Lestrygons
Les Lestrygons (en grec ancien Λαιστρυγόνες / Laistrugónes) sont, dans la mythologie grecque, un peuple mythique féroce et cannibale. Ils sont principalement cités dans l’Odyssée d'Homère, qui parle des « Lestrygons robustes, moins hommes que géants1 » (X, 120).
Mythe
Après son second départ de chez Éole, le maître des Vents, Ulysse touche le septième jour
« (...) au pays lestrygon, sous le bourg de Lamos, la haute Télépyle, où l'on voit le berger appeler le berger : quand l'un rentre, il en sort un autre qui répond ; un homme dégourdi gagnerait deux salaires, l'un à paître les bœufs, l'autre les blancs moutons ; car les chemins du jour côtoient ceux de la nuit. »
(Odyssée, X, 82-86)
Ayant accosté, Ulysse envoie des éclaireurs qui rencontrent la fille d'Antiphatès, le roi des Lestrygons. Celle-ci leur désigne la demeure de son père, mais sitôt qu'ils y entrent, la reine ameute son mari qui tue et dévore plusieurs hommes. Les survivants regagnent les navires, poursuivis par des milliers de Lestrygons qui provoquent un grand massacre parmi les compagnons d'Ulysse. Celui-ci parvient à fuir dans un vaisseau, avec quelques survivants.
Cet épisode précède l'arrivée d'Ulysse chez Circé, sur l'île d'Ééa.
La société des Lestrygons
Les Lestrygons ne sont pas Grecs, mais Homère se les représente fictivement sur le modèle des rois achéens du temps de la guerre de Troie (XIIe siècle avant notre ère) : il leur prête un palais dans une ville haute à laquelle il donne un nom grec, Télépyle, ce qui signifie « la Pylos des Lointains », par opposition à la « Pylos des sables », la cité hellénique du sage Nestor. La ville possède « un port bien connu des marins », au fond d'un bras de mer : « une double falaise, à pic et sans coupure, se dresse tout autour, et deux caps allongés qui se font vis-à-vis au-devant de l'entrée, en étranglent la bouche.»
Les Lestrygons vivent dans une société organisée, au sein d'une ville, en grec ἄστυ, construite au sommet d'une falaise, et pourvue d'une place publique, une agora. « L'illustre palais » de leur roi, qui se nomme Antiphatès, est une belle demeure « aux toits élevés » dominant cette agora. Le peuple des Lestrygons appartient à la race des Géants, et forme un groupe de vaillants guerriers qui se rassemblent dès qu'ils entendent pousser le cri de guerre. L'épouse du roi, « haute comme le sommet d'une montagne », suscite une impression d'effroi chez les compagnons d'Ulysse. Et tout ce monde pratique l'anthropophagie rituelle dans le cadre d'un festin, ce qu'indique le mot grec de δαῖτα.
Localisation des Lestrygons
Bien que présentés sous des traits mythiques, les Lestrygons et leur capitale, Télépyle, ont été localisés dès l'Antiquité par Thucydide en Sicile, là où vivaient aussi les Cyclopes. Le port de cette Télépyle est « bien connu des navigateurs », précise Homère, et en effet, les navigateurs grecs, dès le Xe siècle av. J.C. commerçaient avec le peuple des Tyrrhéniens pour l'importation du minerai de plomb, d'argent ou de cuivre de l'île d'Elbe et de la Sardaigne, et ont pu y faire escale. Mais le fait que les Lestrygons soient un peuple de Géants anthropophages assaillant à coups de blocs de roche les navires, dit clairement que la population de cette Télépyle se montrait féroce pour le contrôle de son port et de la navigation. Si l'on écarte une localisation en Sicile, où aucun site naturel ne répond à la description très précise d'Homère, il reste à situer Télépyle à l'aide des autres indications données par le poète, et qui sont de nature à guider des marins en mer Tyrrhénienne. Chez les Lestrygons, peuple de pasteurs, Homère dit que « le berger appelle le berger », ce qui est l'indice culturel bien connu de ces longs appels modulés que lancent en alternance les gardiens de troupeaux, en Corse et en Sardaigne, lorsqu'ils font mouvement. Que « les chemins du jour avoisinent ceux de la nuit », peut être interprété comme une allusion à la longueur des journées estivales par rapport aux nuits, dans les confins septentrionaux de la Méditerranée occidentale tels que se les représentaient les navigateurs grecs entre le VIIIe et le VIe siècle av. J.C. Comme Victor Bérard, Jean Cuisenier situe donc Télépyle sur la côte sarde, précisément au fond du bras de mer de Porto Pozzo, « le Port du Puits », à l'ouest des îles actuelles de La Maddalena, entre la pointe Monte Rosso et la pointe delle Vacche. L'adéquation entre ce site et la description homérique du port, de ses falaises, et du rocher à l'embouchure est parfaite. En outre, le cap de l'Ours qui se découpe sur la ligne de crête de cette côte, constitue un amer aisément mémorisable, qui signale les sources alentour : la silhouette de cet Ours de roche rouge, dressé sur ses pattes, que signalent aussi Ptolémée et les modernes Instructions nautiques, vérifie donc aussi le vers d'Homère sur « la source de l'Ours aux belles eaux courantes où la ville s'abreuve ».
Les Lestrygons et les ethnies nurraghiques (Corsi, Balari, Iolei)
Selon toute vraisemblance, l'épisode d'Ulysse et des Lestrygons évoque un conflit entre navigateurs grecs et guerriers sardes. Les Lestrygons d'Homère pourraient donc bien avoir pour modèle historique un peuple indigène des côtes sardes. Des échanges étaient en effet pratiqués entre marins grecs et populations sardes à l'époque où Ulysse est censé avoir vécu, entre 1400 et 1180. Ces populations avaient atteint un haut degré de civilisation entre le XIIIe et le VIIIe siècle av. J.C., soit bien avant l'arrivée des Phéniciens et des Carthaginois. Leurs nombreuses constructions mégalithiques, les nuraghe, sont de spectaculaires bâtiments en gros blocs de pierre assemblées sans mortier, avec des tours en forme de cônes tronqués pouvant atteindre vingt mètres de hauteur. La plupart de ces hautes tours sont encore traditionnellement considérées comme l'œuvre de Géants, et nombreux sont les lieux nommés « Tombe di Giganti » en Sardaigne. Le nom même de la mer Tyrrhénienne qui borde ces côtes nord, est et sud de la Sardaigne dérive d'ailleurs de l'ethnique grec Τυρρηνοί ou Τυρσηνοί, qui signifie « bâtisseurs de tours ».



